CNGE
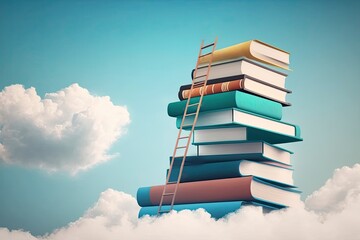
Les productions du CNGE, élaborées par la communauté universitaire des généralistes, sont disponibles pour les étudiants, les enseignants de médecine générale et les médecins généralistes et disponibles sur le site d’Exercer. Parmi ces productions, le CNGE propose des ouvrages disciplinaires.










